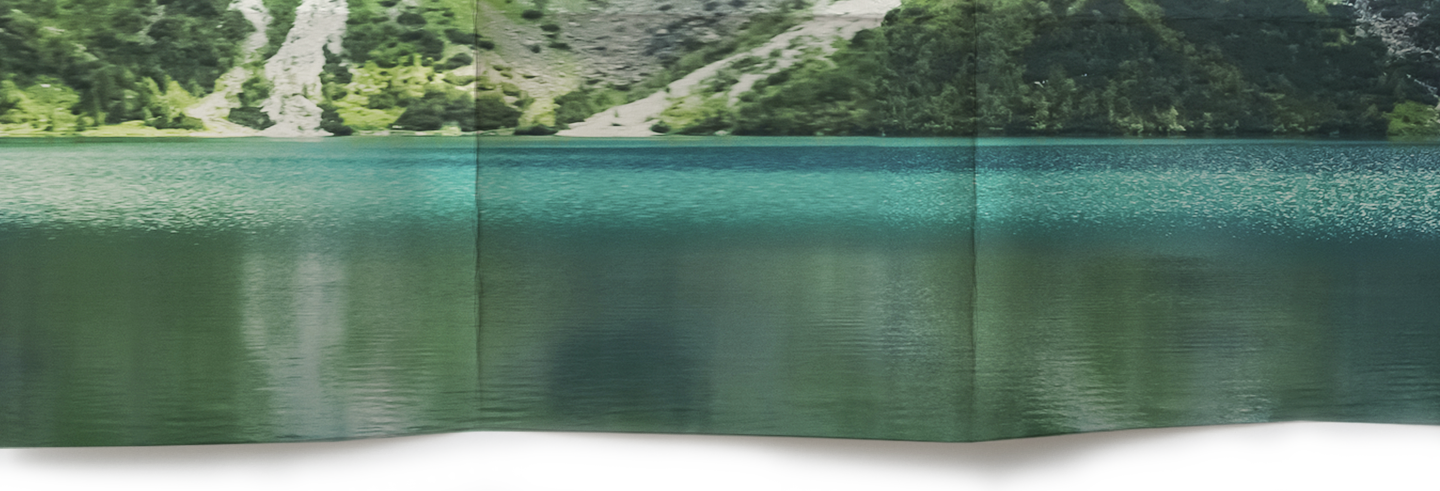Qui sont les camping-caristes, leurs attentes, leur rôle dans l’économie locale ? Comment favoriser leur présence ? Autant de questions que se posent des élus locaux désireux de mieux connaître et surtout de mieux accueillir ces touristes itinérants.

Ils font partie du paysage français. En toutes saisons, les camping-cars sillonnent grands axes et petites routes à la recherche des plus beaux lieux où passer la nuit, à l’affût des sites touristiques connus ou plus secrets. Apparus dans les années 1980, les camping-cars se sont progressivement imposés. Aujourd’hui, 660 000 véhicules de ce type sont recensés en France et 2,7 millions en Europe. L’Hexagone est l’une des destinations favorites des touristes itinérants européens, séduits par la qualité des équipements en plus des charmes touristiques du pays. VDL ce sont des vacances ou des week-ends en plein air, toute l’année, partout dans l’Hexagone. C’est presque un art de vivre. Roland Dorgelès écrivait Le voyage pour moi, ce n’est pas d’arriver quelque part, c’est l’imprévu de la prochaine escale, des joies de connaître sans cesse autre chose. Une citation qui résume la philosophie des adeptes du camping-car.
Le secteur des véhicules de loisirs (VDL) compte d’ailleurs une trentaine d’usines en France, le plus souvent implantées dans des territoires semi-ruraux. Ce savoir-faire, érigé depuis plusieurs décennies, place aujourd’hui la France parmi les leaders européens de la production de camping-cars, une position incarnée par trois grands groupes : Trigano, Rapido et Pilote. Ils totalisent, avec les autres constructeurs français, 5,6 milliards de chiffre d’affaires.
Un moteur économique
Porté par ces grandes entités françaises, le secteur connaît un véritable dynamisme, dont les retombées économiques se font largement sentir dans les territoires. L’essor du camping-car représente une véritable opportunité économique pour la France. Ce mode de voyage contribue à l’allongement des saisons touristiques et participe activement à la dynamisation de l’économie locale, y compris dans des zones moins pourvues en infrastructures touristiques.
Les camping-caristes sillonnent les routes toute l’année, favorisant ainsi une fréquentation régulière et diversifiée de l’Hexagone. D’après le rapport « Camping-caristes : profil et comportements en 2021 » réalisé par Ipsos pour UNI VDL, les propriétaires de camping-cars dépensent en moyenne 39,30 € par jour, et 22 % d’entre eux consacrent plus de 50 € à leurs dépenses quotidiennes. Lors de leurs haltes, ils privilégient principalement : les commerces de bouche (87 %), les supérettes (64 %), les cafés et restaurants (46 %), ce qui profite directement aux acteurs économiques locaux.


Bien accueillir les camping-cars
Une contribution à l’économie locale que de nombreux territoires ont bien comprise. Ils s’attachent donc à proposer le meilleur accueil aux camping-caristes, et cela depuis longtemps pour certains. Ainsi, dès 2007, le canton de Saint-Savin, qui regroupe 16 communes de Gironde, soit environ 22 000 habitants, a élaboré un réseau d’accueil important et réfléchi selon les besoins des camping-caristes, détaille le Cerema dans une fiche intitulée « Élaborer une politique d’accueil des camping-cars ».
- Chaque commune propose une petite aire de stationnement et deux aires de services complétant ainsi le dispositif dans le périmètre du canton.
- Chaque aire dispose d’un panneau d’information indiquant toutes les aires de services ou de stationnement sur le territoire, les sites touristiques principaux, ainsi que les numéros d’urgence et les coordonnées de l’office de tourisme.
Coût global de ces aménagements : environ 30 000 € pour les poubelles, les panneaux d’information placés sur les aires et la signalisation routière (trois panneaux de signalisation par commune en moyenne), auxquels s’ajoute la signalétique mise en place par chaque commune.
Plus récemment, la Cornouaille (Bretagne) a travaillé sur un schéma d’accueil des camping-cars pour l’ensemble du territoire. Les objectifs visaient à : fluidifier la circulation en direction des sites touristiques et mieux répartir les visiteurs, favoriser les déplacements doux, mieux gérer le stationnement sur les sites fréquentés, réduire les impacts pour les voitures et camping-cars sur ces sites sensibles et, plus globalement, mieux accueillir les visiteurs camping-caristes. Une approche qui a permis de créer une typologie d’aires de stationnement et/ou de services, d’identifier des sites “stratégiques” ou encore d’accompagner très concrètement les communes dans la création d’aires de camping-cars.
Dans son schéma communautaire de développement touristique 2021 – 2026, la communauté de communes du Pays des Abers (Finistère) a souhaité améliorer l’accueil et la gestion des touristes. Le tourisme est une filière économique très importante puisqu’il génère 60 millions d’euros de chiffres d’affaires. La collectivité a donc ambitionné de mieux accompagner le fort développement touristique, notamment en travaillant sur l’attractivité des territoires ruraux et péri-urbain pour soulager la partie littorale, en mettant en avant le patrimoine (culturel, patrimonial, les savoir-faire) et enfin en développant une offre de services de qualité. En parallèle, une stratégie marketing favorisant une fréquentation aux quatre saisons a été mise en place. Les camping-caristes sont très présents en Pays Abers : 29 000 séjours, pour 300 000 nuitées touristiques ; 4,7 jours de présence en moyenne ; et 55 euros de dépense moyenne par jour et par personne en 2016 (étude Reflets 2016).
Du côté de l’agglomération d’Aurillac, une étude a été réalisée en partenariat avec le cabinet Atelier Site-Architecture afin de créer un maillage d’aires d’accueil efficace et pertinent pour mieux répondre aux attentes des camping-caristes. « L’idée de ce schéma d’accueil est de désengorger la diagonale touristique qui va de Mandailles-Saint-Julien, au pied du Puy Mary, jusqu’au barrage du Puech des Ouilhes. L’été une navette circule matin, midi et soir afin d’éviter la sur-affluence des voitures et camping-cars sur ces sites. En saison, par exemple, les camping-cars ne peuvent plus monter au sommet du Puy Mary. L’idée est de stationner en bas et d’utiliser ensuite les navettes. » Une étude aujourd’hui entre les mains des élus qui doivent arbitrer les propositions formulées pour garantir une meilleure circulation et un meilleur accueil pour tous les touristes.
Qu’est-ce qu’un camping-car ?
Un camping-car est un véhicule automobile comme un autre. À cette différence près qu’il possède un compartiment habitable qui permet aux habitants de dormir, préparer des repas et, dans la majorité des cas, se doucher.
- PTAC < 3,5 tonnes → conduite avec un simple permis B.
- Stationnement : il peut se garer partout où les voitures le peuvent.
Catégories de camping-cars :
- Les profilés : lignes aérodynamiques, consommation réduite.
- Les capucines : lit au-dessus de la cabine.
- Les intégraux : haut de gamme, chambre séparée, salon intégré à la cabine.
- Les fourgons aménagés : utilitaires transformés, appréciés pour leur maniabilité.
- Les vans aménagés : < 2 m de haut, passent partout mais confort plus limité.
Très appréciés des Français, les camping-cars bénéficient d’une forte visibilité auprès du grand public, notamment via le Salon des VDL (chaque année depuis 1966 à Paris-Le Bourget), ainsi que de nombreux salons et foires régionaux.

« Nous avons également des circuits thématiques » Questions à Christel Rigolot, Chargée de relations publiques, Meuse Attractivité
Avez-vous une politique spécifique d’accueil des camping-caristes inscrite dans votre stratégie touristique ?
Une stratégie globale en faveur du public de camping-caristes a été élaborée il y a une quinzaine d’années afin de répondre aux souhaits et besoins de cette clientèle spécifique en s’appuyant sur les partenaires touristiques, les collectivités, les usagers. Des magazines spécialisés ont aussi été démarchés pour relayer l’offre touristique du département. La Meuse, au cœur de la région Grand Est, à mi-chemin entre Paris et Strasbourg, est une destination rurale aux paysages changeants et agréables à sillonner. C’est un territoire qui se prête idéalement aux séjours en itinérance.
Avez-vous travaillé sur un schéma de circulation ?
Des circuits thématiques ont été élaborés pour inciter à explorer la destination au départ du Lac de Madine, le plus grand lac de Lorraine dans l’environnement préservé du Parc naturel régional de Lorraine et autour de Bar-le-Duc, ville d’art et d’histoire dotée d’un patrimoine Renaissance parmi les mieux conservés de France.
Comment vos travaux se sont-ils traduits en termes de gestion des flux et de signalisation sur votre territoire ?
Les collectivités ont été accompagnées pour la création d’aires de stationnement et de services pour doter le territoire de façon cohérente de sites adaptés aux besoins des camping-caristes.
Travaillez-vous avec des associations de camping-caristes, des prestataires privés ou d’autres collectivités pour améliorer l’accueil ?
C’était alors le point fort de la démarche tout comme le développement d’un partenariat public-privé qui a permis de bénéficier de conseils d’experts, notamment en travaillant avec le concessionnaire CLC.
Comment communiquez-vous auprès des camping-caristes ?
Nous avons référencé des aires de camping-car sur le site web www.lameuse.fr avec l’identification de sites attrayants où passer la nuit tels que la Boîte à madeleines, la fabrique des Dragées Braquier. Nous avons également créé des circuits thématiques de la mémoire vivante aux rencontres d’un terroir authentique et gourmand en passant par des sites comme Vent des Forêts, où l’art contemporain se découvre sur les sentiers à ciel ouvert.
Nous accueillons aussi en reportage des supports spécialisés qui valorisent l’exploration à vélo ou à pied autour du lieu de stationnement que ce soit le long de la Meuse et de son itinéraire EV19, autour de la Citadelle de Montmédy ou dans les forêts d’Argonne… L’itinérance en van et en véhicule équipé de tente de toit est également encouragée et Meuse Attractivité s’est rendu au festival international de la tente de toit organisé au Lac de Madine du 12 au 14 septembre 2025 avec une offre dédiée.
Comment évaluez-vous la fréquentation et la satisfaction des camping-caristes sur votre territoire ?
Les offices de tourisme du territoire au contact direct des visiteurs ainsi que l’enquête clients durant la saison 2025 permettront, d’ici la fin de l’année, d’évaluer la présence des camping-caristes et la satisfaction de l’expérience de séjour.
DES AIDES AU FINANCEMENT DES AIRES D’ACCUEIL ET / OU DE SERVICES
De nombreuses aides existent pour la création ou la rénovation d’aires de services ou de stationnement à destination des camping-caristes. Elles peuvent venir de la Région, d’un département ou d’une communauté de communes. Il est parfois difficile pour les élus de connaître les possibilités en la matière. Pour les éclairer, le Comité de liaison des camping-cars (CLC) a élaboré à l’attention des collectivités locales un « Guide des aides et subventions accordées aux communes et aux EPCI pour la création, la rénovation ou la mise aux normes des aires de camping-cars ». Un document précieux pour mieux connaître les possibilités de financement dédiées à l’accueil des camping-cars !

Retrouvez ce guide sur :
www.univdl.com/guide-des-subventions/
Renforcer l’attractivité
En matière d’accueil des camping-caristes, l’information ne manque pas : de nombreuses ressources sont à leur disposition pour organiser leurs itinéraires et repérer les lieux propices aux haltes. Des guides spécialisés comme Les Plus Beaux Détours de France, le réseau d’accueil à la ferme France Passion, les publications Michelin, Petit Futé, ou encore la presse spécialisée, proposent une multitude de suggestions, d’aires référencées et de circuits adaptés aux camping-cars.
À cela s’ajoutent les supports fournis par les offices de tourisme – cartes, brochures, sites internet – qui permettent de valoriser les services et les points d’intérêt locaux. C’est également sur les réseaux sociaux et les plateformes collaboratives que ces voyageurs connectés échangent le plus. Les groupes Facebook, forums, blogs et applications de géolocalisation jouent un rôle clé dans la diffusion de ces « bonnes adresses ». Ce bouche-à-oreille numérique, alimenté par les retours d’expérience et les recommandations entre camping-caristes, se révèle d’une efficacité redoutable : une aire bien accueillante ou un village commerçant peut rapidement gagner en visibilité et devenir une halte incontournable.
Dans ce contexte, les collectivités ont tout intérêt à soigner leur communication, tant sur leurs supports traditionnels que numériques. Une signalétique claire, une présence active sur les réseaux, des partenariats avec la presse et les guides spécialisés, ainsi qu’une stratégie de communication alignée avec les attentes des camping-caristes sont autant d’actions susceptibles de renforcer l’attractivité du territoire.